Le mot folklore n’est pas aussi ancien qu’on pourrait le croire. Il n’est apparu qu’au XIXe siècle, bien que les traditions qu’il désigne existent depuis des millénaires. Avant ce mot, les gens ne parlaient pas de « folklore » pour décrire les chansons, les contes, les danses ou les coutumes transmises de génération en génération. Ils les vivaient simplement. C’était la vie quotidienne, pas un sujet d’étude. Alors, d’où vient ce mot étrange qui nous semble aujourd’hui si naturel ?
La naissance du mot « folklore » en 1846
Le terme « folklore » a été inventé en 1846 par un antiquaire anglais du nom de William John Thoms. Il cherchait un mot pour désigner les traditions populaires que les savants commençaient à recueillir dans les campagnes. À l’époque, les mots comme « superstition », « coutume » ou « légende » étaient utilisés, mais ils avaient une connotation péjorative. Thoms voulait un terme neutre, scientifique, qui ne juge pas. Il a donc créé « folklore » en combinant deux mots anglo-saxons : « folk », qui signifie « peuple », et « lore », qui veut dire « savoir » ou « tradition ». Le mot littéral est donc « savoir du peuple ».
Il a publié cette proposition dans une lettre au journal The Athenaeum, en signant sous le pseudonyme « Ambrose Merton ». Ce n’était pas une blague. Il voulait que les chercheurs prennent au sérieux ce que les paysans, les ouvriers, les artisans racontaient autour du feu. À l’époque, beaucoup pensaient que ces histoires étaient des fadaises. Thoms a montré qu’elles étaient des trésors culturels.
Comment le mot a traversé l’Europe
Le mot « folklore » s’est répandu rapidement en Europe, surtout dans les pays où les intellectuels cherchaient à redécouvrir leurs racines. En Allemagne, les frères Grimm avaient déjà recueilli des contes depuis 1812, mais ils parlaient de « Volksmärchen » (contes du peuple). En France, les écrivains comme Jules Michelet ou Prosper Mérimée ont commencé à s’intéresser aux récits régionaux dans les années 1830, mais ils n’avaient pas encore de mot pour les désigner. Ce n’est qu’après 1850 que « folklore » a été adopté en français, d’abord par les linguistes, puis par les ethnologues.
En France, le mot a d’abord été utilisé dans les milieux universitaires. Il a fallu attendre les années 1880 pour qu’il entre dans le langage courant. Les collecteurs de chansons populaires, comme François-Marie Luzel en Bretagne, ont joué un rôle clé. Ils ont voyagé de village en village, notant les paroles, les mélodies, les gestes. Sans eux, beaucoup de traditions auraient disparu. Et sans le mot « folklore », ces efforts n’auraient peut-être pas été reconnus comme un champ d’étude légitime.

Le folklore, ce n’est pas que les danses et les costumes
Quand on entend « folklore », on pense souvent aux costumes colorés, aux danses en cercle, aux instruments comme la bombarde ou le biniou. Mais le folklore, c’est bien plus. C’est aussi les proverbes qu’on répète à la cuisine, les rituels pour protéger les récoltes, les contes racontés aux enfants avant de dormir, les recettes transmises de mère en fille. C’est ce que les gens font sans se demander pourquoi. Ce sont les gestes anciens qui survivent au changement du monde.
En Auvergne, par exemple, on disait encore au début du XXe siècle que si on ne nettoyait pas les outils de la ferme avant la Saint-Jean, les vaches ne donneraient plus de lait. Ce n’était pas une superstition pour les gens de l’époque - c’était une règle de vie. Aujourd’hui, on la trouve étrange. Mais c’est exactement ce que le folklore désigne : des savoirs qui n’ont pas été écrits, mais qui ont été vécus.
Les instruments de musique folklorique : des objets vivants
Les instruments de musique folklorique ne sont pas simplement des objets. Ce sont des extensions du corps, des témoins de l’histoire locale. En Provence, le castagnette n’est pas qu’un instrument de percussion. C’est un outil de rythme qui a accompagné les vendanges depuis des siècles. En Normandie, le biniou n’est pas un simple cornemuse : il est lié à la danse du fest-noz, où chaque pas raconte une histoire. En Alsace, le musette a été utilisé dans les mariages, les veillées, les fêtes de village. Il a été remplacé par les accordéons modernes, mais les anciens le gardent encore dans les greniers, comme un lien avec les grands-parents.
Ces instruments n’ont pas été inventés par des musiciens professionnels. Ils ont été fabriqués par des artisans locaux, avec du bois, de la peau, du métal récupéré. Leur son était imparfait, parfois criard, mais il était vrai. Il ne cherchait pas à plaire à une salle de concert. Il voulait réveiller les gens, marquer le temps, accompagner les travaux des champs. C’est ce qui fait leur force : ils sont nés de l’usage, pas du spectacle.
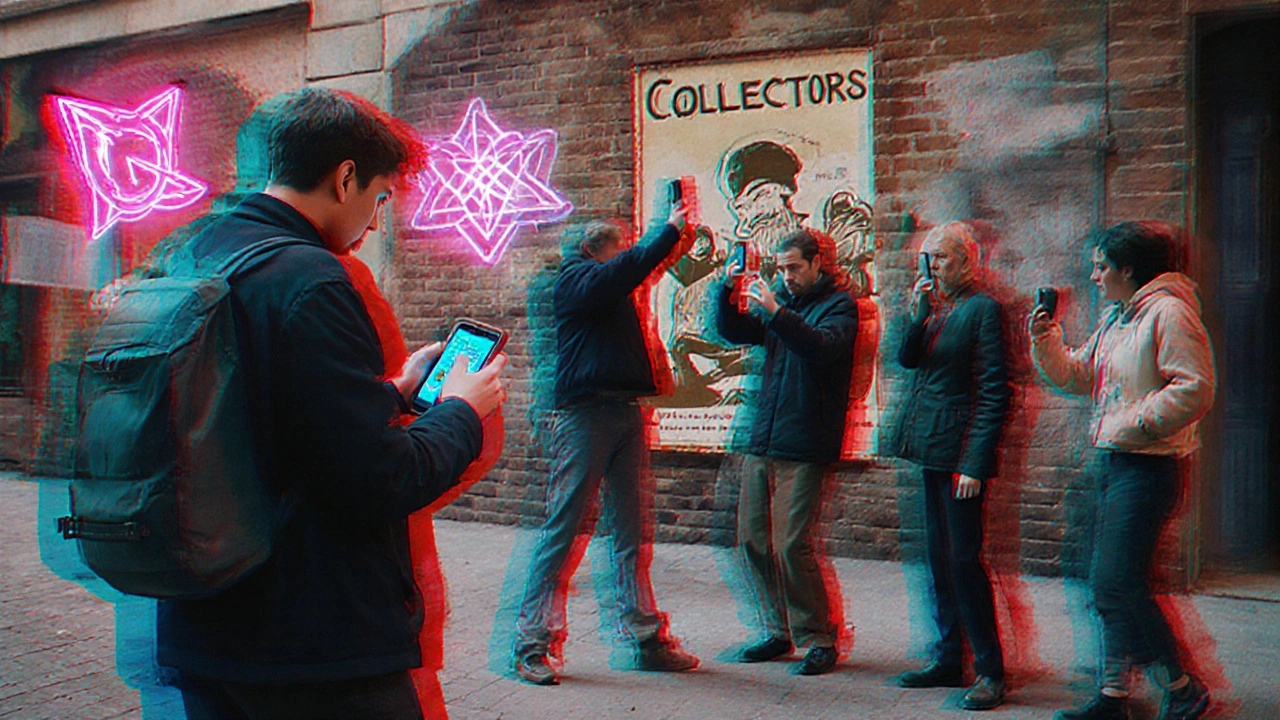
Le folklore, une résistance à l’homogénéisation
À la fin du XIXe siècle, la France était en train de devenir un État centralisé. L’école républicaine imposait le français standard. Les dialectes étaient punis. Les traditions locales étaient considérées comme des obstacles à la modernité. Le mot « folklore » est devenu, à ce moment-là, un outil de résistance. Ceux qui le prononçaient disaient : « Ce que nous faisons, ce que nous chantons, ce que nous croyons, ça compte. »
Les collecteurs de folklore n’étaient pas des nostalgiques. Ils étaient des archivistes. Ils savaient que si on ne notait pas ces traditions, elles disparaîtraient avec la génération qui les portait. Aujourd’hui, on voit des jeunes reprendre les chants de leur région, jouer du cabrette dans les festivals, apprendre les pas de danse de leur grand-mère. Ce n’est pas une mode. C’est une réappropriation. Le folklore n’est pas mort. Il se transforme.
Le mot « folklore » est-il encore adapté aujourd’hui ?
Depuis les années 1970, certains chercheurs remettent en question le mot « folklore ». Pour eux, il évoque quelque chose de figé, de pittoresque, de « muséifié ». Il suggère que ces traditions sont du passé, alors qu’elles sont encore vivantes. On préfère aujourd’hui parler de « traditions vivantes », de « patrimoine immatériel » - un terme adopté par l’UNESCO en 2003.
Pourtant, « folklore » reste le mot le plus courant. Il est simple. Il est précis. Il ne cherche pas à être élégant. Il dit simplement : ce sont les savoirs du peuple. Et c’est ce qu’il faut garder. Ce n’est pas une collection de costumes exposés dans un musée. C’est ce que les gens font encore aujourd’hui, dans les villages du Lot, dans les rues de Marseille, dans les fêtes de la Saint-Éloi en Ardèche.
Le mot « folklore » n’est pas une étiquette. C’est une porte. Une porte qui mène à ce que les gens ont toujours fait pour se souvenir d’eux-mêmes. Il ne faut pas le sauver. Il faut le vivre.
Le mot « folklore » vient-il vraiment de l’anglais ?
Oui, le mot « folklore » a été créé en anglais en 1846 par William John Thoms, en combinant « folk » (peuple) et « lore » (savoir). Il a été adopté ensuite par les chercheurs français et autres pays européens. Même s’il est maintenant utilisé dans de nombreuses langues, son origine linguistique est anglo-saxonne.
Le folklore est-il seulement une affaire de campagne ?
Non. Le folklore existe aussi en ville. Les chants de travail dans les usines, les légendes urbaines, les rituels des quartiers, les jeux d’enfants dans les cours d’école - tout cela est du folklore. Il ne dépend pas du lieu, mais du mode de transmission : oral, vécu, collectif. Les traditions urbaines sont parfois plus invisibles, mais pas moins réelles.
Pourquoi les instruments folkloriques sont-ils souvent en bois ?
Parce que le bois était la matière la plus accessible dans les campagnes. Les artisans fabriquaient les instruments avec ce qu’ils avaient sous la main : chêne, noyer, érable, roseau. Le métal était cher, et les technologies de fabrication industrielle n’existaient pas. Le bois permettait aussi une sonorité chaude, proche de la voix humaine, ce qui correspondait à l’usage : accompagner les chants, pas les remplacer.
Le folklore est-il en train de disparaître ?
Il ne disparaît pas - il change. Les jeunes ne dansent plus comme leurs grands-parents, mais ils réinventent les danses avec des sons modernes. Les chansons traditionnelles sont reprises en rap ou en électro. Le folklore n’est pas mort : il se réinvente. Ce qui disparaît, c’est l’idée qu’il doit rester figé. La vraie menace, c’est quand on le réduit à un spectacle touristique.
Quel est le lien entre folklore et langue régionale ?
Le folklore et les langues régionales sont profondément liés. Les contes, les chansons, les proverbes ne peuvent pas être traduits sans perdre leur sens. Une chanson en occitan a une rythmique, des jeux de mots, des images qui n’existent pas en français. Le folklore est porté par la langue. Sans langue, il devient un décor. Avec la langue, il reste vivant.



Écrire un commentaire